Les indispensables
Par Simon Boulerice
Qu’est-ce qu’une infirmière ou un infirmier auxiliaire ?
En français, le mot « auxiliaire » peut convenir à une profession, oui, mais aussi à un verbe.
Dans le sens premier, l’auxiliaire veut dire : « qui aide par son concours, sans être indispensable ».
Parfois, la langue française fait fausse route : être auxiliaire, c’est indispensable.
Et c’est ce que croyait l’infirmière Charlotte Tassé, une femme de tête et de cœur.
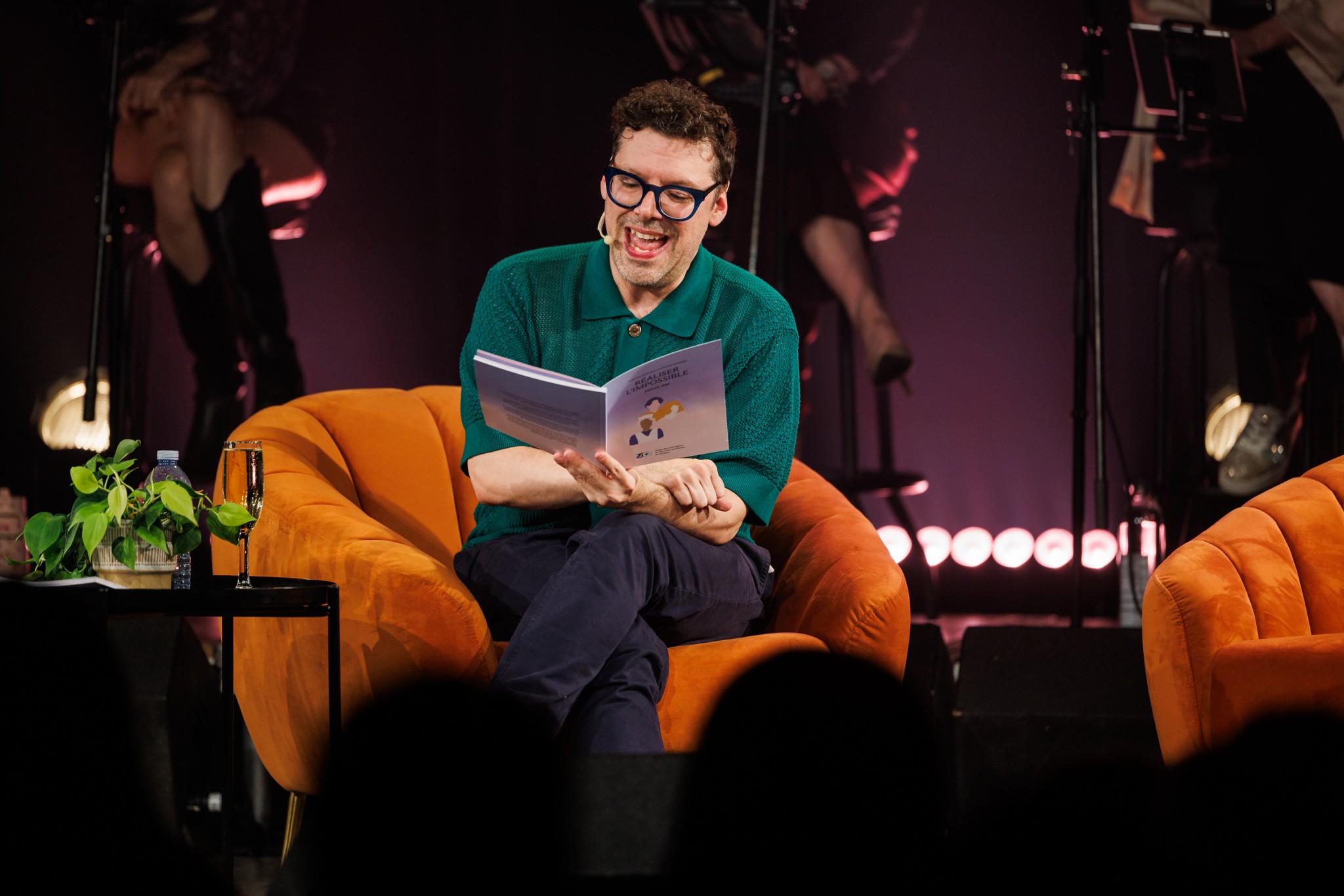
Commençons par elle, Charlotte, car l’histoire qui nous intéresse aujourd’hui part d’elle.
Alors voilà : c’est l’histoire d’une visionnaire québécoise qui voit le manque criant de personnel dans le réseau de la santé.
Un jour, il y a de cela 75 ans, elle a l’ambition de créer une profession dédiée aux soins de chevet des patients, un concept importé des États-Unis.
Elle crée l’École de gardes-malades auxiliaires.
Engouement instantané : les premières garde-malades auxiliaires obtiennent leur diplôme en 1951 et arboreront bientôt l’insigne créée par Tassé où brille une abeille cernée de ce slogan : S’oublier pour soulager.
Charlotte, c’est la bougie d’allumages pour une trâlée d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires animés par le désir de prendre soin.
Et les années qui suivront verront l’essor d’une profession à part entière.
Rapidement, le souhait collectif, c’est d’acquérir plus d’autonomie et de reconnaissance.
En 1968, cette formation passe des mains des hôpitaux à celles de l’État, et les cours se donnent dans les polyvalentes publiques.
En 1974, c’est la création de la Corporation professionnelle des infirmières et des infirmiers auxiliaires.
Un code de déontologie et quelques acquis suivront durant la décennie…
Et ce désir noble : que la corporation puisse jouer pleinement son rôle de protecteur.
Mais un climat d’incertitude prolongé : beaucoup de limitations, certaines frustrations.
Un recadrage du champ d’activité dans les années 80, question de désentraver les couloirs de tous les obstacles quotidiens.
La création de comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires en 1991, qui va redonner un nouvel élan à la profession.
C’est déterminant : ces membres font maintenant partie des instances où se discutent l’amélioration de la qualité des soins infirmiers.
Ça vient solidifier le sentiment d’appartenance et de fierté des membres envers leur profession.
La corporation s’ordonne : elle devient un Ordre, avec ce pictogramme revu depuis quelques années, celui de la main tendue, symbole fort, évocateur, et toujours pertinent.
Mais des menaces planent à la fin du précédant siècle : le désir gouvernemental d’abolir la profession au profit d’un poste d’ « assistants aux bénéficiaires ».
147 000 signatures plus tard, l’Ordre, alors présidé par Régis Paradis se bat pour la survie de la profession. La disparition n’est pas une option.
Et les mots de Gérald Larose, alors président de la Confédération des syndicats nationaux devant 5000 personnes rassemblées sous la pluie à l’Assemblée nationale : « S’il y a un bout d’humanité qui reste dans ce réseau-là, ce sont les infirmières et les infirmiers auxiliaires qui le personnalisent. »
Le caractère humanitaire dont parlait déjà Charlotte Tassé dès les années 50.
Il est là le dénominateur commun avec les infirmières et les infirmiers auxiliaires.
Avec le vieillissement de la population, ils sont essentiels à la solution avec les soins à domicile.
Ils sont l’incarnation du sens : service essentiel.
Les troupes se mobilisent.
Les infirmières et infirmiers auxiliaires vont au front depuis 75 ans, habité.e.s par la même pulsion depuis leurs origines : soigner et être là.
Et ils sont aussi nombreux que précieux.
Aujourd’hui, l’Ordre professionnel compte pas moins de 32 000 membres!
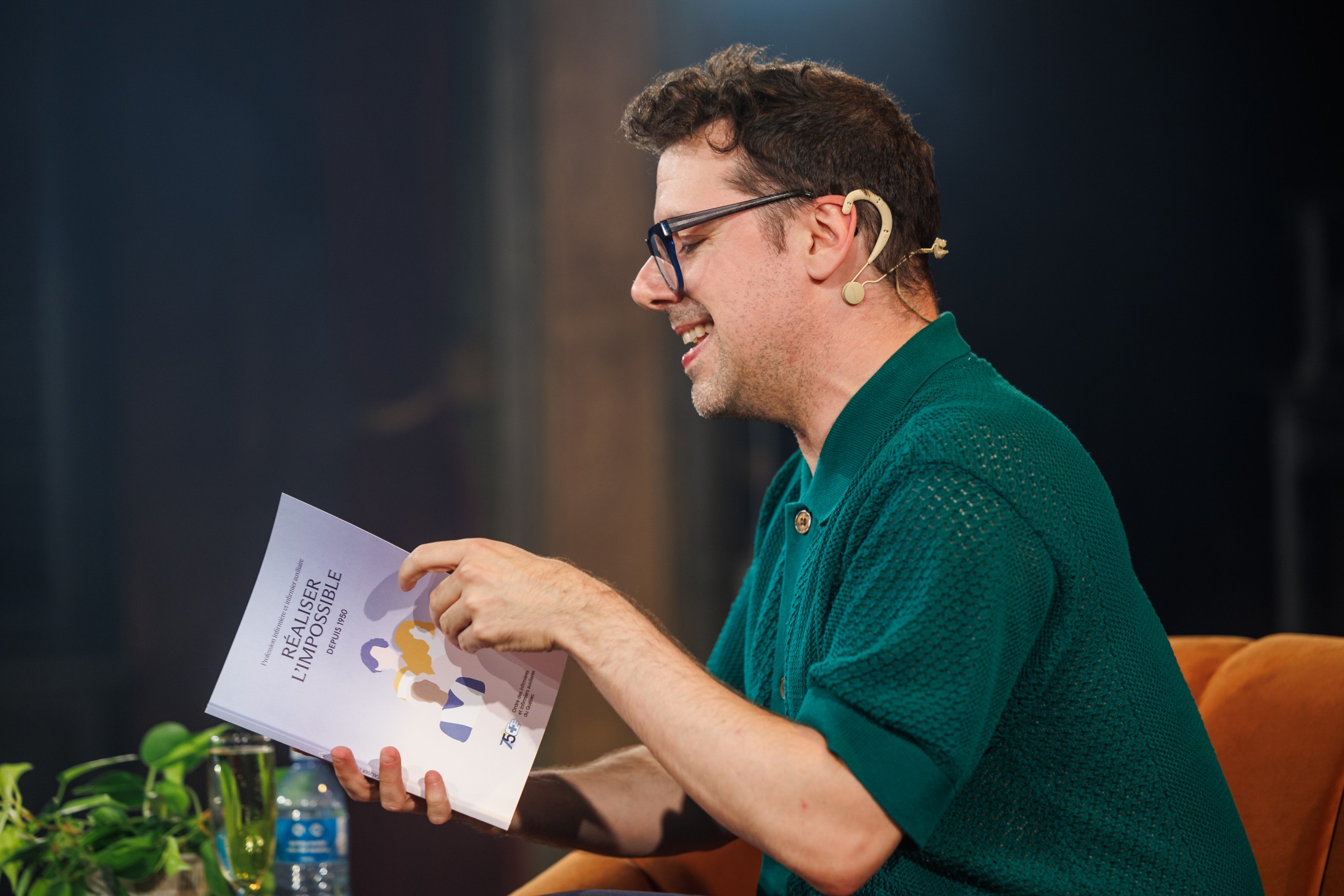 |  |
Parmi eux, il y a Nancy qui égaie ses patients en hémodialyse qui reçoivent trois fois par semaine quatre heures de traitement.
Elle fait aller sa joie radioactive, son positivisme, et son écoute réelle et entière, elle transforme l’expérience des patients réellement patients.
Il y a Mary-Claude, en gériatrie, qui un jour commence son quart de travail auprès d’une dame en fin de vie : Madame Tremblay aux cheveux mauves, à force de shampoing mauve qu’elle gardait trop longuement avant le rinçage.
Son état périclite, la famille doit venir la veiller rapidement.
L’infirmier les appelle, mais ils sont loin, à plus de 40 minutes.
Alors Mary-Claude s’assoit à ses côtés et la flatte en récitant une prière.
Madame Tremblay est partie rassurée, en paix, et surtout pas abandonnée, veillée par l’infirmière auxiliaire qui m’a dit : « Tsé, Simon, c’est ça mon métier, au fond : soigner, pis être juste là, toute là. »
Il y a Patrick, en soins palliatifs, qui prend soin de Monique.
Monique qui aimait tant pêcher, quand elle en avait l’énergie.
Il lui restait peu de temps à vivre.
Alors Patrick et ses collègues ont créé une activité : ils sont allés chercher une piscine pour enfants, et l’ont remplie de truites ensemencées.
Alors Monique, accompagnée de ses enfants, s’est retrouvée sur son balcon à pêcher, bien assise dans son fauteuil roulant.
Et ç’a mordu!
À la fin de la journée, la cuisinière a fait cuire sa récolte pour qu’elle puisse manger le fruit de son labeur paisible.
Il y a Benoit, dans l’équipe de soutien à domicile, le chouchou de Madame Gaudreault,
Il prodigue des soins, des farces, et une dose de réconfort.
Il y a Hugues-Armand qui prend soin de ses patients comme s’ils étaient ses parents et qui ne perd jamais de vue que c’est lui qui rend visite, qui entre chez le patient.
Il y a Marie-Pier, douée pour redonner espoir et dignité à ses patients, qui a su relever les bons signes pour repérer les effets secondaires de la médication de Madame Grondin et ainsi permettre au médecin de l’ajuster.
Il y a une autre Marie-Pierre qui a écouté précautionneusement une pré-ado qui souffrait de dysmorphie de genre.
Il y a les boxeuses et infirmières auxiliaires Elena Revel et Kim Clavel qui conjuguent leur vie d’athlète à leur parcours d’infirmière auxiliaire, unies par la même passion. Kim prend ça si à cœur que lorsqu’elle a installé sa première sonde urinaire à une patiente qui venait d’accoucher, elle était plus stressée qu’avant un combat !
Il y a Annick, qui a été une adolescente malade, dont a pris soin Marie-Ève. Elle l’a écoutée, l’a rassurée. Elle a tant aimé la considération reçue qu’à son tour, une fois guérie, Annick est devenue une infirmière auxiliaire. Pour redonner au suivant.
Il y a Stéphane qui est parti soigner dans le Grand Nord en pleine COVID et qui a tout fait pour respecter la mort d’un de ses patients selon ses rites et ses traditions.
Qui l’a respecté jusqu’au bout.
Dans ses us, ses coutumes, ses prières et ses larmes.
L’histoire des infirmières et des infirmiers auxiliaires peut s’incarner en cinq grands verbes historiques pour la profession : Naître, S’affirmer, Lutter, Triompher, S’épanouir.
Mais il faudrait ajouter aussi tout le champ lexical de la consolation, du réconfort, de la proximité, des soins longue durée…
En français, le mot « auxiliaire » peut convenir à une profession, oui, mais aussi à un verbe.
Le verbe auxiliaire est utilisé pour former les temps composés des autres verbes.
Par exemple, « avoir » et « être » sont des verbes auxiliaires.
Il a apaisé sa douleur.
Elle est sortie de la chambre une fois que le patient était en paix.

